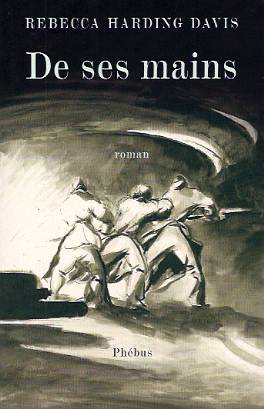
Après avoir soumis à vos curiosités Le Monstre de Gaston Chérau, il apparaît que nous traversons une phase nouvelles et novella. Il nous faudra ajouter Au coeur des ténèbres et Un avant-poste du progrès de Joseph Conrad pour souligner une fois encore la saisissante poigne des textes courts où fuse, puissante, la littérature qui nous souffle. Et qu’est-ce qui nous intéresserait d’autre ? une saga pouâcre façon Millenium ? un jus de chaussette au tire-ligne façon Zafon ? Allons, allons. Même le Nostromo de Conrad, qui poussait là son grand-oeuvre, nous paraît bougrement moins prenant, quoique plus ambitieux, et surtout moins “moderne”, si cela veut dire quelque chose. Alors disons moins uppercut, moins mandale, moins mandala.
Trève de bavardage : en avril 1861, la revue américaine Atlantic Monthly publiait anonymement Life in the Iron Mills, un texte de Rebecca Harding Davis devenu un classique de la littérature américaine. Et un classique du naturalisme, pour tout dire, devançant d’assez loin Emile Zola.
Née à Washington (Penns.) le 24 juin 1831, décédée à Mount Kisco (NY) le 29 septembre 1910, R. H. Davis est passée inaperçue en France. Elle a trente ans lorsqu’elle publie son récit. Installée à Wheeling avec sa famille, elle trace le tableau d’une cité ouvrière nouvellement fondée, un champignon sidérurgique qui a cru sur une petite ville tranquille, salissant tout, les hommes et les femmes pour commencer. Dans un paysage décrit avec brio - que dire de pages dont les images font oublier les mots ? -, les hauts-fourneaux dévorent du métal et de l’énergie humaine, ils laminent de l’acier et des corps humains harassés de fatigue, de malnutrition, décérébrés. Parmi les ouvriers, un homme, Hugh, a eu une idée - c’est assez exceptionnel pour que des bourgeois visitant la fonderie s’en aperçoivent : il sculpte dans les coulures de métal des personnages réalistes. Son goût de la beauté le distingue, les bourgeois oiseux et surpris s’emparent d’un aussi fier sujet et leurs propos lui ouvrent les yeux. Pour son malheur.
Pour en savoir plus, chez nous, sur l’auteur de ce petit miracle littéraire, dur et poignant, il faudra probablement attendre la publication éventuelle de ses écrits inédits réunis récemment aux Vanderbilt University Press, Writing cultural autobiography (2001). Ils avaient d’abord paru sous le titre de Bits of gossip, cela devrait attirer un éditeur… Mais cela ne nous explique pas comment ce récit formidable n’avait jamais paru en France. Aurait-il été seulement traduit en revue ? On devrait interroger un spécialiste du naturalisme, mais, en août, on n’en a pas sous la main.
Rebecca Harding Davis De ses mains. Roman traduit de l’anglais (USA) par Carole Zalberg. — Paris, Phébus, 95 p., 5, 90 euros